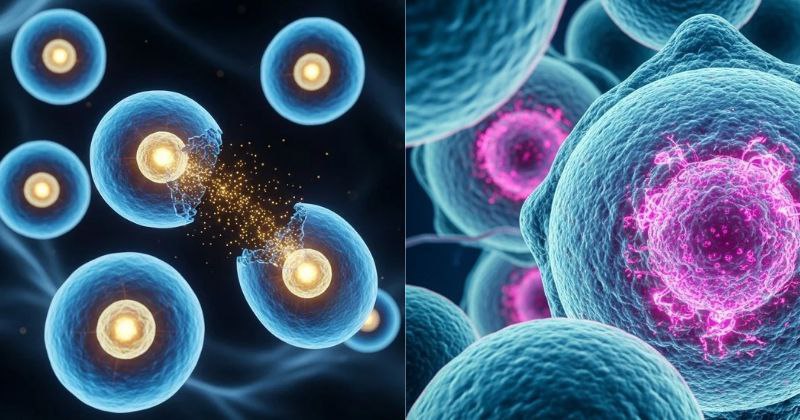L’autophagie représente un mécanisme cellulaire fondamental découvert par le biologiste japonais Yoshinori Ohsumi, lauréat du prix Nobel de physiologie ou médecine en 2016. Ce processus d’auto-digestion cellulaire permet à l’organisme de dégrader et recycler ses composants endommagés, particulièrement lors de périodes de restriction calorique. Les recherches contemporaines démontrent que l’activation de l’autophagie par le jeûne intermittent pourrait exercer des effets protecteurs contre le vieillissement cellulaire, les pathologies neurodégénératives et diverses affections métaboliques. Cet article examine les fondements moléculaires de l’autophagie, ses mécanismes d’activation par le jeûne, et ses implications potentielles pour la santé humaine, tout en présentant l’état actuel des connaissances scientifiques dans ce domaine en pleine expansion.
Contexte et Arrière-plan
L’autophagie, terme dérivé du grec ancien signifiant « se manger soi-même », constitue un processus cellulaire conservé au cours de l’évolution, présent chez tous les eucaryotes. Ce mécanisme de dégradation lysosomale permet l’élimination sélective d’organites dysfonctionnels, de protéines agrégées et de pathogènes intracellulaires. Les travaux pionniers d’Ohsumi dans les années 1990 sur la levure Saccharomyces cerevisiae ont permis l’identification de plus de 40 gènes ATG (Autophagy-related genes) essentiels à ce processus.
L’intérêt scientifique pour l’autophagie s’est considérablement accru depuis la dernière décennie, avec plus de 15 000 publications indexées entre 2015 et 2024, reflétant son importance dans la physiologie cellulaire. Les données épidémiologiques suggèrent que le dysfonctionnement autophagique est impliqué dans plus de 50 pathologies humaines, incluant les maladies d’Alzheimer, de Parkinson, le diabète de type 2 et diverses formes de cancer.
La restriction calorique et le jeûne intermittent sont reconnus depuis longtemps comme des interventions augmentant la longévité dans de nombreux modèles animaux. Des études sur Caenorhabditis elegans ont démontré une augmentation de 40% de la durée de vie sous restriction calorique, un phénomène partiellement médié par l’activation de l’autophagie. Ces observations ont conduit à une investigation approfondie des liens mécanistiques entre jeûne, autophagie et santé métabolique.
Analyse des Concepts Clés
L’autophagie se décline en trois formes principales, chacune caractérisée par des mécanismes distincts et des fonctions spécifiques. La macroautophagie, forme la plus étudiée, implique la formation d’une double membrane, l’autophagosome, qui séquestre le matériel cytoplasmique destiné à la dégradation. Cette vésicule fusionne ensuite avec le lysosome, organite contenant des enzymes hydrolytiques, pour former l’autolysosome où s’effectue la dégradation.
La microautophagie se caractérise par l’invagination directe de la membrane lysosomale pour englober de petites portions de cytoplasme. Bien que moins étudiée, elle contribue significativement au renouvellement constitutif des composants cellulaires. L’autophagie médiée par les chaperones (CMA) représente un mécanisme hautement sélectif où des protéines chaperonnes, notamment HSC70, reconnaissent des séquences peptidiques spécifiques (motif KFERQ) sur les protéines substrats et les transloquent directement à travers la membrane lysosomale via le récepteur LAMP2A.
Le processus macroautophagique comprend plusieurs étapes séquentielles finement régulées. L’initiation requiert l’activation du complexe ULK1 (Unc-51-like kinase 1), régulé négativement par mTOR (mechanistic target of rapamycin) et positivement par l’AMPK (AMP-activated protein kinase). La nucléation implique le complexe PI3K de classe III (phosphatidylinositol 3-kinase) contenant Beclin-1, VPS34 et ATG14. L’élongation et la fermeture de l’autophagosome nécessitent deux systèmes de conjugaison ubiquitine-like : le système ATG12-ATG5-ATG16L1 et le système LC3-PE (phosphatidyléthanolamine), où LC3-I est lipidé en LC3-II pour s’ancrer à la membrane de l’autophagosome.
Exploration Approfondie
Les voies de signalisation régulant l’autophagie constituent un réseau complexe intégrant les statuts énergétique, nutritionnel et hormonal de l’organisme. La protéine kinase mTOR agit comme senseur nutritionnel central, intégrant les signaux provenant des acides aminés, du glucose et des facteurs de croissance. En conditions de suffisance nutritionnelle, mTORC1 (mTOR complex 1) phosphoryle et inhibe le complexe ULK1, bloquant ainsi l’initiation de l’autophagie. Inversement, la déplétion en nutriments désactive mTORC1, levant cette inhibition.
L’AMPK représente le senseur énergétique majeur de la cellule, activé lorsque le ratio AMP/ATP augmente, signalant un déficit énergétique. L’AMPK activée phosphoryle directement ULK1 sur des sites distincts de ceux ciblés par mTOR, stimulant l’autophagie. Simultanément, l’AMPK inhibe mTORC1 via la phosphorylation de TSC2 (tuberous sclerosis complex 2) et de Raptor, amplifiant l’induction autophagique. Cette régulation bidirectionnelle par mTOR et AMPK positionne l’autophagie comme processus adaptatif aux variations métaboliques.
Le jeûne intermittent, pratique consistant à alterner des périodes d’alimentation et d’abstinence alimentaire, active puissamment l’autophagie selon des cinétiques précises. Des études sur modèles murins démontrent une augmentation significative des marqueurs autophagiques (ratio LC3-II/LC3-I, dégradation de p62/SQSTM1) après 16 à 24 heures de jeûne. Chez l’humain, les données suggèrent une activation progressive débutant après 12 à 16 heures de jeûne, avec un pic d’activité entre 24 et 48 heures.
Les mécanismes moléculaires sous-jacents impliquent plusieurs axes. La déplétion en glucose réduit la production d’ATP mitochondrial, activant l’AMPK. La diminution des acides aminés circulants, particulièrement la leucine, désactive mTORC1 via des senseurs comme Sestrin2. L’augmentation des corps cétoniques (β-hydroxybutyrate, acétoacétate) produits par β-oxydation hépatique exerce également des effets modulateurs sur l’autophagie, bien que les mécanismes précis restent débattus.
L’autophagie sélective, ou autophagie cargo-spécifique, cible préférentiellement certains substrats via des récepteurs d’autophagie. La mitophagie, dégradation sélective des mitochondries dysfonctionnelles, représente un mécanisme crucial de contrôle qualité énergétique. Les protéines PINK1 et Parkine orchestrent ce processus : PINK1 s’accumule sur les mitochondries dépolarisées, recrutant Parkine qui ubiquitine les protéines mitochondriales externes, signalant leur séquestration autophagique. La perturbation de la mitophagie est impliquée dans la pathogenèse de la maladie de Parkinson, où des mutations de PINK1 et Parkine sont observées dans les formes familiales.

Applications Pratiques et Implications
Applications Actuelles
Les protocoles de jeûne intermittent se sont diversifiés, offrant différentes modalités d’implémentation. Le jeûne 16/8 (16 heures de jeûne, fenêtre alimentaire de 8 heures) constitue l’approche la plus populaire, compatible avec le rythme circadien et relativement facile à maintenir. Le jeûne alterné (alternance de jours d’alimentation normale et de restriction sévère à 500-600 kcal) induit une activation autophagique plus prononcée mais présente des défis d’adhérence. Le jeûne 5:2 (alimentation normale 5 jours, restriction 2 jours non consécutifs) représente un compromis entre efficacité et praticabilité.
Les données cliniques émergentes suggèrent des bénéfices métaboliques significatifs. Une méta-analyse de 27 essais contrôlés randomisés (n=944 participants) a démontré une réduction moyenne de 7% du poids corporel et une amélioration de 6% de la sensibilité à l’insuline après 8 à 24 semaines de jeûne intermittent. Ces effets semblent partiellement médiés par l’activation autophagique, bien que la contribution spécifique de ce mécanisme reste difficile à quantifier in vivo chez l’humain.
L’application thérapeutique de l’autophagie dans les pathologies neurodégénératives constitue un axe de recherche prometteur. L’accumulation de protéines mal conformées (β-amyloïde dans la maladie d’Alzheimer, α-synucléine dans la maladie de Parkinson, huntingtine dans la maladie de Huntington) représente une caractéristique pathognomonique, et l’autophagie assure normalement leur élimination. Des études précliniques sur modèles murins ont démontré que l’activation pharmacologique de l’autophagie par la rapamycine réduit l’accumulation protéique et améliore les déficits cognitifs.
Dans le domaine oncologique, le rôle dual de l’autophagie complexifie son exploitation thérapeutique. L’autophagie basale exerce un effet suppresseur tumoral en prévenant l’accumulation de dommages cellulaires et l’instabilité génomique. Paradoxalement, dans les tumeurs établies, l’autophagie favorise la survie cellulaire dans le microenvironnement hypoxique et nutritivement déficitaire. Cette dichotomie a conduit au développement d’inhibiteurs autophagiques comme la chloroquine et l’hydroxychloroquine, actuellement évalués en combinaison avec les chimiothérapies conventionnelles dans plusieurs essais cliniques de phase II et III.
Implications Futures
Les perspectives de recherche s’orientent vers le développement de modulateurs autophagiques spécifiques et sélectifs. Les inducteurs pharmacologiques actuels (rapamycine, metformine, spermidine) présentent des limitations liées à leur manque de spécificité et leurs effets pléiotropes. L’identification de petites molécules ciblant sélectivement les différentes formes d’autophagie (macroautophagie, mitophagie, CMA) représente un objectif majeur. Des composés comme les activateurs allostériques d’ULK1 ou les modulateurs de Beclin-1 sont en phase d’investigation préclinique.
L’émergence des biomarqueurs autophagiques circulants pourrait révolutionner le monitoring clinique. Actuellement, l’évaluation de l’autophagie nécessite des biopsies tissulaires et l’analyse immunohistochimique de marqueurs comme LC3 et p62, approche invasive et difficilement applicable en routine. Des travaux explorent le potentiel diagnostique de vésicules extracellulaires contenant des composants autophagiques, de métabolites spécifiques ou de modifications épigénétiques circulantes comme reflets de l’activité autophagique systémique.
L’interface entre autophagie et médecine de précision ouvre des horizons personnalisés. La variabilité interindividuelle dans la réponse autophagique au jeûne, influencée par des facteurs génétiques (polymorphismes des gènes ATG), épigénétiques et métabolomiques, suggère la nécessité d’approches stratifiées. Les profils génomiques pourraient identifier les individus « répondeurs » susceptibles de bénéficier maximalement d’interventions pro-autophagiques.
La chronobiologie de l’autophagie constitue un axe émergent. L’autophagie présente des variations circadiennes régulées par l’horloge moléculaire, avec une activité accrue durant la phase de repos/jeûne nocturne. L’alignement temporel du jeûne intermittent avec les rythmes circadiens endogènes (time-restricted feeding aligné sur la photopériode) pourrait optimiser l’induction autophagique et amplifier les bénéfices métaboliques, une hypothèse actuellement testée dans plusieurs essais cliniques.
Perspectives d’Experts et Points de Vue Professionnels
Les autorités scientifiques internationales émettent des positions nuancées concernant l’autophagie et le jeûne. Le Dr David Rubinsztein, professeur de génétique moléculaire à l’Université de Cambridge, dont les travaux pionniers ont élucidé les mécanismes autophagiques dans les maladies neurodégénératives, souligne que « l’activation de l’autophagie représente une stratégie thérapeutique prometteuse, mais nous devons distinguer soigneusement les effets spécifiquement médiés par l’autophagie des autres conséquences de la restriction calorique ».
Le Dr Guido Kroemer, directeur de recherche INSERM et professeur à l’Université Paris Cité, considéré comme l’un des experts mondiaux de l’autophagie, avance que « la modulation pharmacologique de l’autophagie pourrait prévenir ou retarder de nombreuses pathologies liées au vieillissement ». Ses recherches récentes identifient la spermidine, polyamine naturelle, comme inducteur autophagique prolongeant la durée de vie dans multiples organismes modèles, avec des essais cliniques explorant ses effets cardioprotecteurs chez l’humain.
Le Dr Valter Longo, gérontologue à l’Université de Californie du Sud, pionnier du jeûne thérapeutique, propose le concept de « diète mimant le jeûne » (fasting-mimicking diet). Ses études suggèrent que des cycles périodiques de restriction calorique sévère (5 jours par mois) induisent une régénération tissulaire médiée par l’autophagie, avec des bénéfices observés dans des essais cliniques sur des patients atteints de sclérose en plaques et de diabète. Néanmoins, il insiste sur la nécessité d’une supervision médicale pour ces interventions.
Cependant, certains chercheurs adoptent une position plus circonspecte. Le Dr Eileen White, professeur à l’Université Rutgers et experte en autophagie tumorale, avertit que « l’activation systémique de l’autophagie pourrait théoriquement favoriser la progression de tumeurs non diagnostiquées, particulièrement chez les personnes âgées à risque accru de néoplasies ». Cette préoccupation justifie la prudence dans l’application universelle d’interventions pro-autophagiques sans stratification appropriée.
L’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation (ANSES) maintient une position prudente, reconnaissant les données précliniques prometteuses tout en soulignant l’insuffisance actuelle d’essais cliniques à long terme chez l’humain. L’agence recommande que toute intervention de jeûne prolongé soit entreprise sous surveillance médicale, particulièrement pour les populations vulnérables (personnes âgées, patients polymédiqués, individus avec comorbidités).
Défis et Considérations
La transposition des découvertes précliniques à la clinique humaine se heurte à plusieurs obstacles méthodologiques majeurs. L’absence de biomarqueurs autophagiques validés et accessibles limite considérablement l’évaluation de l’activité autophagique in vivo chez l’humain. Les marqueurs tissulaires (LC3-II, p62) nécessitent des biopsies invasives et reflètent un état statique plutôt que le flux autophagique dynamique. Cette limitation technique complique l’établissement de relations dose-effet entre interventions (jeûne, pharmacologie) et activité autophagique réelle.
Les considérations éthiques entourant le jeûne thérapeutique requièrent une attention particulière. Les populations vulnérables (femmes enceintes ou allaitantes, enfants, adolescents, personnes âgées fragiles, patients souffrant de troubles du comportement alimentaire, individus avec insuffisance rénale ou hépatique avancée) présentent des contre-indications absolues ou relatives au jeûne prolongé. Le risque de récupération inappropriée de ces pratiques par des mouvements pseudo-scientifiques nécessite une communication scientifique rigoureuse et nuancée.
La durabilité et l’adhérence à long terme des protocoles de jeûne intermittent constituent des défis pragmatiques significatifs. Les études observationnelles rapportent un taux d’abandon de 30 à 40% après 6 mois, principalement attribué aux contraintes sociales, à la faim et aux effets secondaires transitoires (fatigue, irritabilité, céphalées). L’intégration sociale de l’alimentation rend difficile le maintien de fenêtres alimentaires restrictives, particulièrement dans les contextes familiaux et professionnels.
Les interactions médicamenteuses potentielles méritent une vigilance accrue. Le jeûne modifie la pharmacocinétique et la pharmacodynamie de nombreux médicaments, affectant leur absorption, distribution, métabolisation et élimination. Les patients sous anticoagulants, antidiabétiques oraux, antihypertenseurs ou immunosuppresseurs requièrent un ajustement posologique et un monitoring rapproché lors de l’instauration de protocoles de jeûne. Cette complexité nécessite une collaboration étroite entre prescripteurs et nutritionnistes cliniciens.
Les limites de nos connaissances actuelles concernant les effets différentiels selon l’âge, le sexe, le statut métabolique et le patrimoine génétique constituent des lacunes importantes. Les études animales suggèrent que les bénéfices de la restriction calorique sont maximaux lorsqu’elle est initiée précocement, tandis que son instauration tardive chez des organismes âgés pourrait être moins efficace, voire délétère dans certains contextes. Les données humaines longitudinales à très long terme (décennies) sont inexistantes, limitant les conclusions sur les effets cumulatifs.
Bonnes Pratiques et Recommandations
L’implémentation d’un protocole de jeûne intermittent devrait idéalement suivre une approche progressive et individualisée. Une période d’adaptation de 2 à 4 semaines, débutant par des fenêtres de jeûne modérées (12 heures) progressivement étendues à 16 heures, favorise l’adaptation métabolique et améliore l’adhérence. Cette progressivité permet également l’identification précoce d’effets indésirables ou de contre-indications méconnues.
Le maintien d’un apport nutritionnel adéquat durant les fenêtres alimentaires représente un impératif souvent négligé. La restriction temporelle ne doit pas conduire à une malnutrition qualitative. Les repas doivent couvrir les besoins en macronutriments (protéines de haute valeur biologique à 1,2-1,6 g/kg de poids corporel, lipides essentiels, glucides complexes) et micronutriments (vitamines, minéraux, oligoéléments). Une densité nutritionnelle élevée est particulièrement critique pour prévenir les carences lors de fenêtres alimentaires réduites.
L’hydratation durant les périodes de jeûne nécessite une attention particulière. La consommation de 2 à 3 litres d’eau par jour est recommandée, avec possibilité d’inclure des boissons non caloriques (thé, café sans sucre, tisanes). Certains puristes préconisent l’évitement complet des édulcorants artificiels, susceptibles de déclencher une réponse insulinique céphalique, bien que les preuves de leur impact sur l’autophagie restent limitées.
Le monitoring clinique et biologique s’avère prudent lors de l’instauration d’un jeûne intermittent, particulièrement pour les individus présentant des comorbidités. Une évaluation initiale incluant glycémie à jeun, HbA1c, bilan lipidique, fonction rénale et hépatique établit une ligne de base. Un suivi à 3 et 6 mois permet d’objectiver les bénéfices métaboliques et de détecter d’éventuelles déviations pathologiques. Les patients diabétiques sous traitement hypoglycémiant requièrent un ajustement posologique anticipé et une surveillance glycémique rapprochée.
L’intégration d’activité physique durant le jeûne intermittent amplifie potentiellement les bénéfices autophagiques, bien que les modalités optimales restent débattues. L’exercice en état de jeûne (fasted cardio) active synergiquement l’AMPK et l’autophagie, mais peut altérer les performances dans les activités de haute intensité. Un compromis raisonnable consiste à privilégier les exercices d’endurance modérée en état de jeûne et les entraînements de résistance ou de haute intensité durant les fenêtres alimentaires, optimisant ainsi la préservation de la masse musculaire.
La complémentation ciblée pourrait soutenir les processus autophagiques, bien que les preuves cliniques restent préliminaires. La spermidine (1-6 mg/jour), présente naturellement dans le blé germé, le soja fermenté et certains fromages, a démontré des propriétés pro-autophagiques dans plusieurs essais cliniques, avec une amélioration de 12% de la fonction cognitive et une réduction des biomarqueurs cardiovasculaires dans une étude autrichienne sur 829 participants suivis durant 20 ans. Le resvératrol, les polyphénols du thé vert (EGCG) et la curcumine présentent également des propriétés modulatrices de l’autophagie in vitro, mais leur biodisponibilité limitée questionne leur efficacité in vivo.
Surveillance et Perspectives d’Avenir
Les technologies émergentes de détection autophagique révolutionneront prochainement le monitoring clinique. Les sondes fluorescentes sensibles au pH (pHluorine-LC3, mCherry-GFP-LC3) permettent le suivi en temps réel du flux autophagique, mais restent actuellement confinées à la recherche fondamentale. Le développement de capteurs portables non invasifs, basés sur la spectroscopie ou l’analyse de volatils organiques exhalés corrélant avec l’activité autophagique, représente un objectif technologique ambitieux.
L’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique s’intègrent progressivement à la recherche autophagique. Des algorithmes de deep learning analysent des images de microscopie pour quantifier automatiquement les structures autophagiques, surpassant l’analyse humaine en rapidité et reproductibilité. Des modèles prédictifs intégrant données génomiques, transcriptomiques, protéomiques et métabolomiques pourraient identifier les signatures moléculaires prédisant la réponse individuelle aux interventions pro-autophagiques.
Les approches de thérapie génique ciblant l’autophagie émergent comme stratégies thérapeutiques futuristes. La vectorisation adéno-associée (AAV) de gènes ATG dans le système nerveux central a démontré une efficacité préclinique dans des modèles murins de maladies neurodégénératives. Réciproquement, les technologies CRISPR-Cas9 permettent l’inactivation sélective de gènes autophagiques pour tester leurs rôles spécifiques dans diverses pathologies, accélérant l’identification de cibles thérapeutiques.
L’exploration des interactions microbiote-autophagie constitue une frontière scientifique fascinante. Le microbiome intestinal module l’autophagie de l’épithélium intestinal, influençant la perméabilité barrière et l’homéostasie immune. Inversement, l’autophagie des cellules épithéliales régule la composition microbienne via la xénophagie (autophagie des pathogènes). Des interventions combinant modulation du microbiote (prébiotiques, probiotiques, transplantation fécale) et induction autophagique pourraient synergiser dans le traitement des maladies inflammatoires chroniques intestinales.
Le concept de « mimétiques du jeûne » pharmaceutiques gagne en traction. Plutôt que d’imposer des restrictions alimentaires contraignantes, le développement de molécules reproduisant les signatures métaboliques et signalétiques du jeûne permettrait de découpler les bénéfices autophagiques des défis d’adhérence. Des candidats comme les inhibiteurs de mTOR de nouvelle génération (rapalogs sélectifs), les activateurs directs d’AMPK, ou les cétones exogènes sont en investigation préclinique avancée.
Les implications sociétales et économiques d’interventions pro-autophagiques efficaces seraient considérables. Le vieillissement démographique et l’augmentation des pathologies chroniques métaboliques et neurodégénératives représentent des défis sanitaires majeurs pour les systèmes de santé. Si les approches basées sur l’autophagie démontrent une efficacité préventive ou thérapeutique robuste, elles pourraient réduire significativement l’incidence de maladies coûteuses, avec des répercussions économiques positives substantielles. Toutefois, l’équité d’accès à ces interventions, qu’elles soient comportementales ou pharmacologiques, devra être garantie pour éviter d’aggraver les inégalités de santé existantes.
Conclusion et Points Clés à Retenir
L’autophagie représente un processus cellulaire fondamental dont la modulation par le jeûne intermittent offre des perspectives thérapeutiques considérables. Les mécanismes moléculaires régulant l’autophagie (axe mTOR-AMPK, complexes protéiques ATG, formes sélectives comme la mitophagie) sont désormais bien caractérisés, bien que leur intégration systémique et leurs variations interindividuelles nécessitent des investigations approfondies.
Les données précliniques démontrent de manière convaincante les bénéfices de l’activation autophagique sur la longévité, la santé métabolique et la résistance aux pathologies liées au vieillissement dans de multiples modèles animaux. Les études cliniques humaines, bien que moins nombreuses et de durée limitée, suggèrent des effets métaboliques favorables du jeûne intermittent, probablement partiellement médiés par l’autophagie, quoique la contribution spécifique de ce mécanisme reste difficile à isoler.
Les applications thérapeutiques potentielles dans les maladies neurodégénératives, métaboliques et oncologiques justifient la poursuite intensive des recherches, tout en maintenant une rigueur méthodologique stricte et une communication scientifique nuancée évitant les extrapolations excessives. Le développement de biomarqueurs accessibles, de modulateurs pharmacologiques spécifiques et d’approches personnalisées constituera les pierres angulaires de la translation clinique efficace.
Pour les individus en bonne santé intéressés par les approches de jeûne intermittent, une implémentation progressive, un maintien de la qualité nutritionnelle, une hydratation adéquate et, idéalement, un accompagnement par des professionnels de santé formés représentent les conditions optimales. Les populations vulnérables doivent impérativement être exclues de ces pratiques en dehors d’un cadre médical strictement supervisé.
L’avenir de la recherche autophagique s’annonce riche en découvertes transformatives, à l’interface de la biologie cellulaire, de la médecine translationnelle, des technologies de monitoring et de l’intelligence artificielle. La convergence de ces disciplines pourrait catalyser l’émergence d’interventions préventives et thérapeutiques révolutionnant notre approche du vieillissement et des pathologies chroniques, tout en soulevant des questions éthiques et sociétales nécessitant un débat public éclairé.
Sources et Références
Source principale :
- Ohsumi Y. « Historical landmarks of autophagy research ». Cell Research. 2014;24(1):9-23. (Travaux nobelisés sur l’autophagie)
- Mizushima N, Levine B. « Autophagy in human diseases ». New England Journal of Medicine. 2020;383(16):1564-1576.
Données complémentaires :
- Rubinsztein DC, et al. « Autophagy modulation as a potential therapeutic target for diverse diseases ». Nature Reviews Drug Discovery. 2012;11(9):709-730.
- Kroemer G, et al. « Autophagy in the pathogenesis of disease ». Cell. 2013;132(1):27-42.
- Longo VD, Mattson MP. « Fasting: molecular mechanisms and clinical applications ». Cell Metabolism. 2014;19(2):181-192.
- de Cabo R, Mattson MP. « Effects of intermittent fasting on health, aging, and disease ». New England Journal of Medicine. 2019;381(26):2541-2551.
Autorités consultées :
- Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM), France
- Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation (ANSES)
- Centre de Recherche en Biologie Cellulaire de Montpellier (CRBM)
- Université de Cambridge, Department of Medical Genetics
- University of California San Diego, Longevity Institute
Avertissement
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un avis médical. Les protocoles de jeûne intermittent peuvent présenter des contre-indications et des risques pour certaines populations. Consultez impérativement un professionnel de santé qualifié (médecin, diététicien-nutritionniste) avant d’entreprendre toute modification significative de vos habitudes alimentaires, particulièrement si vous présentez des conditions médicales préexistantes, prenez des médicaments régulièrement, ou appartenez à une population vulnérable. Les informations présentées ne remplacent en aucun cas un diagnostic, un traitement ou des conseils médicaux personnalisés.