La galaxie du Triangle, désignée Messier 33 (M33), constitue l’un des objets du ciel profond les plus accessibles pour l’observation amateur, tout en demeurant méconnue du grand public. Située à environ 2,7 millions d’années-lumière dans la constellation du Triangle, cette galaxie spirale représente le troisième membre le plus massif du Groupe local après la Voie lactée et la galaxie d’Andromède. Malgré sa magnitude apparente de 5,7, M33 offre aux observateurs munis de simples jumelles une opportunité exceptionnelle d’observer une structure galactique extérieure à notre propre système. Cet article examine les caractéristiques physiques de cette galaxie, les techniques d’observation optimales, et l’importance scientifique de M33 dans notre compréhension de l’évolution galactique et de la structure cosmique à grande échelle.
Contexte Astronomique et Découverte Historique
La galaxie du Triangle fut documentée pour la première fois en 1764 par l’astronome français Charles Messier, qui l’intégra à son célèbre catalogue des objets nébuleux. Toutefois, des observations antérieures non publiées avaient probablement été effectuées par Giovanni Battista Hodierna dès 1654. L’identification de M33 comme galaxie spirale distincte ne survint qu’au début du XXe siècle, grâce aux travaux révolutionnaires d’Edwin Hubble et de ses contemporains, qui établirent la nature extragalactique de ces « nébuleuses spirales ».
M33 occupe une position privilégiée dans l’histoire de l’astronomie moderne. En 1926, Edwin Hubble utilisa les étoiles variables céphéides de cette galaxie pour calculer sa distance, contribuant ainsi à démontrer l’existence de galaxies au-delà de la Voie lactée. Cette découverte fondamentale transforma radicalement notre compréhension de l’échelle de l’Univers.
Avec un diamètre d’environ 60 000 années-lumière et une masse stellaire estimée entre 10 et 40 milliards de masses solaires, M33 représente une galaxie spirale de taille intermédiaire. Sa proximité relative et son orientation quasi face-on (inclinaison d’environ 54 degrés par rapport à notre ligne de visée) en font un laboratoire cosmique exceptionnel pour l’étude de la structure spirale, de la formation stellaire et de la dynamique galactique.
Caractéristiques Astrophysiques Fondamentales
Structure Morphologique et Composition
M33 présente une morphologie spirale de type Sc selon la classification de Hubble, caractérisée par des bras spiraux relativement lâches et un bulbe central peu développé. Cette configuration structurelle contraste nettement avec la galaxie d’Andromède (M31), qui exhibe un bulbe proéminent et des bras spiraux plus serrés. L’analyse spectroscopique révèle que M33 contient approximativement 40 milliards d’étoiles, accompagnées de vastes régions de gaz interstellaire et de poussières cosmiques.
La distribution de la matière dans M33 suit un profil exponentiel typique des disques galactiques, avec une densité stellaire décroissant progressivement du centre vers la périphérie. Les observations en infrarouge, notamment celles effectuées par le télescope spatial Spitzer, ont permis de cartographier la distribution des étoiles anciennes et de révéler des structures subtiles invisibles en lumière visible, incluant des extensions externes du disque galactique s’étendant bien au-delà de la région optiquement brillante.
Activité de Formation Stellaire
M33 se distingue par un taux de formation stellaire exceptionnellement élevé, estimé à environ 0,4 masse solaire par an. Cette activité intense se manifeste par la présence de plus de 200 régions HII cataloguées, vastes nébuleuses d’hydrogène ionisé par le rayonnement ultraviolet des étoiles massives nouvellement formées. La plus remarquable de ces régions, NGC 604, s’étend sur approximativement 1 500 années-lumière et contient plus de 200 étoiles massives de type O et B, produisant un éclat équivalent à 6 000 fois celui de la nébuleuse d’Orion.
Les études spectroscopiques multi-longueurs d’onde, combinant observations ultraviolettes, optiques et infrarouges, révèlent que la formation stellaire dans M33 n’est pas uniformément distribuée mais concentrée le long des bras spiraux et dans des complexes moléculaires géants. Cette distribution spatiale reflète les mécanismes physiques de compression gravitationnelle et de chocs dans le milieu interstellaire, processus fondamentaux déclenchant l’effondrement des nuages moléculaires et la genèse de nouvelles générations stellaires.
Dynamique Orbitale et Interactions Gravitationnelles
Position dans le Groupe Local
M33 constitue un membre relativement modeste mais scientifiquement crucial du Groupe local, assemblage gravitationnellement lié comprenant plus de 80 galaxies dans un volume d’environ 10 millions d’années-lumière de diamètre. La galaxie du Triangle orbite probablement autour de la galaxie d’Andromède, bien que les paramètres orbitaux précis demeurent sujets à débat dans la communauté astronomique. Les mesures astrométriques récentes, particulièrement celles obtenues par le satellite Gaia de l’Agence spatiale européenne, suggèrent une vitesse tangentielle de M33 cohérente avec un mouvement orbital autour de M31, avec une période estimée entre 3 et 6 milliards d’années.
Indices d’Interactions Passées
Les observations à haute résolution spatiale révèlent des asymétries morphologiques subtiles et des perturbations dans la distribution de la matière de M33, suggérant des interactions gravitationnelles passées avec d’autres membres du Groupe local. Les simulations numériques de dynamique galactique proposent qu’une rencontre rapprochée avec M31 aurait pu survenir il y a environ 2 à 3 milliards d’années, événement qui expliquerait certaines caractéristiques structurelles observées, notamment la distribution asymétrique du gaz neutre et les perturbations cinématiques détectées dans le disque externe.
La cinématique du gaz hydrogène neutre (HI), cartographiée en détail par radiointerférométrie, exhibe des déviations significatives par rapport à une rotation circulaire simple, incluant des mouvements non-circulaires et des extensions gazeuses s’étendant bien au-delà du disque stellaire. Ces signatures cinématiques constituent des traceurs précieux des perturbations gravitationnelles et des processus d’accrétion de matière, phénomènes cruciaux pour comprendre l’évolution à long terme des galaxies spirales.
Méthodologies d’Observation pour Astronomes Amateurs
Conditions Optimales et Équipement Recommandé
L’observation de M33 présente des défis spécifiques liés à sa faible luminosité surfacique, paramètre quantifiant la brillance apparente distribuée sur l’étendue angulaire de l’objet. Avec une magnitude apparente intégrée de 5,7 mais une extension angulaire d’environ 73 × 45 minutes d’arc (approximativement 1,4 fois le diamètre apparent de la Lune), M33 possède une luminosité surfacique moyenne de seulement 14,2 magnitudes par seconde d’arc carrée, rendant sa détection délicate en présence de pollution lumineuse.
Les conditions d’observation idéales requièrent:
- Transparence atmosphérique élevée: absence de brume, humidité réduite
- Ciel sombre: magnitude limite visuelle ≥ 6,0, idéalement en site de classe Bortle 3 ou inférieur
- Adaptation à l’obscurité complète: minimum 20-30 minutes pour maximiser la sensibilité rétinienne
- Absence de Lune: période de nouvelle lune ou phase lunaire minimale
L’instrumentation optimale varie selon l’expérience de l’observateur. Les jumelles de configuration 10×50 ou 15×70 représentent l’instrument minimal permettant la détection de M33, révélant une tache diffuse de forme ovale. Un télescope de 150-200 mm de diamètre sous ciel sombre permet de résoudre les régions HII les plus brillantes et de percevoir la structure spirale, tandis qu’un instrument de 300 mm ou plus révèle des détails structurels subtils, incluant les bras spiraux et les condensations de formation stellaire.
Techniques de Repérage et Stratégies Visuelles
Le repérage de M33 s’effectue en utilisant la constellation du Triangle comme point de départ. La galaxie se positionne approximativement à mi-chemin entre l’étoile α Trianguli (Mothallah, magnitude 3,4) et α Andromedae (Alpheratz, magnitude 2,1), légèrement décalée vers le nord. Une approche méthodique consiste à pointer initialement α Trianguli, puis à déplacer le champ visuel progressivement vers le nord-est sur environ 3,5 degrés.
La vision décalée (averted vision) constitue une technique essentielle pour l’observation des objets de faible luminosité surfacique. Cette méthode exploite la distribution non uniforme des cellules photoréceptrices rétiniennes, particulièrement la concentration accrue de bâtonnets (photorécepteurs sensibles à la faible luminosité mais insensibles aux couleurs) dans la périphérie rétinienne. En dirigeant le regard légèrement à côté de M33 plutôt que directement sur elle, l’observateur maximise la détection des photons par les régions rétiniennes les plus sensibles.
L’utilisation de filtres optiques sélectifs peut améliorer substantiellement la visibilité des régions HII. Les filtres à bande étroite centrés sur la raie d’émission H-alpha (656,3 nm) ou les filtres UHC (Ultra High Contrast) transmettant les raies OIII (495,9 et 500,7 nm) et H-beta (486,1 nm) augmentent le contraste entre les régions d’émission et le fond de ciel, révélant les complexes de formation stellaire qui demeureraient autrement invisibles.
Contributions Scientifiques et Recherches Contemporaines
M33 comme Laboratoire Extragalactique
La proximité et l’orientation favorable de M33 en font un objet d’étude privilégié pour multiples domaines de l’astrophysique contemporaine. Les programmes d’observation systématiques, notamment le « PHAT-like survey of M33 » (PAndAS M33 survey) et les observations multi-époques du télescope spatial Hubble, ont permis de résoudre individuellement des millions d’étoiles, construisant des diagrammes couleur-magnitude détaillés révélant l’histoire de formation stellaire de la galaxie sur les derniers milliards d’années.
Les études de populations stellaires résolues démontrent que M33 a connu plusieurs épisodes de formation stellaire accrue au cours de son histoire, probablement corrélés avec des interactions gravitationnelles et des événements d’accrétion de gaz. L’analyse des abondances chimiques, effectuée via spectroscopie haute résolution de régions HII et d’étoiles supergéantes, révèle un gradient de métallicité radial, avec des abondances décroissant du centre vers la périphérie galactique, signature caractéristique de l’enrichissement chimique progressif par nucléosynthèse stellaire.
Variables Céphéides et Échelle des Distances Cosmiques
M33 héberge une population substantielle d’étoiles variables céphéides, pulsatoires lumineuses exhibant une relation précise entre leur période de pulsation et leur luminosité intrinsèque. Cette relation période-luminosité, établie initialement par Henrietta Leavitt en 1908, constitue un échelon fondamental de l’échelle des distances cosmiques. Les observations photométriques systématiques de céphéides dans M33, conduites notamment avec les télescopes spatiaux Hubble et Spitzer, ont permis de calibrer avec une précision accrue cette relation cruciale, réduisant ainsi les incertitudes sur les distances extragalactiques.
Les mesures récentes, incorporant des corrections pour l’extinction interstellaire et la métallicité, établissent une distance vers M33 de 2,73 ± 0,07 millions d’années-lumière, valeur essentielle pour calibrer les indicateurs de distance secondaires utilisés pour sonder l’univers lointain et mesurer le taux d’expansion cosmique (constante de Hubble-Lemaître).
Applications Pratiques en Astrophotographie Amateur
Protocoles d’Imagerie Numérique
L’astrophotographie de M33 requiert une approche méthodologique rigoureuse, combinant équipement adapté, technique d’acquisition optimisée et traitement d’image sophistiqué. Les caméras astronomiques refroidies à capteur CMOS ou CCD, avec leur faible bruit de lecture et leur efficacité quantique élevée, représentent l’instrumentation privilégiée pour l’imagerie profonde.
Un protocole d’acquisition typique comprend:
- Poses individuelles: 300-600 secondes en filtres à bande large (LRGB) ou à bande étroite (H-alpha, OIII, SII)
- Temps d’intégration total: minimum 5-10 heures pour révéler les structures faibles
- Images de calibration: darks (même température et durée que les poses scientifiques), flats (correction du vignettage et des poussières), bias (niveau de fond électronique)
- Guidage précis: autoguidage avec précision RMS < 1 seconde d’arc pour éviter l’étalement des étoiles
L’orientation face-on de M33 la rend particulièrement adaptée aux objectifs photographiques et télescopes de courte focale (rapport focal f/4 à f/6), permettant de capturer l’étendue complète de la galaxie tout en maintenant un temps d’exposition raisonnable par pose individuelle. Les montages à grand champ avec des focales de 400-600 mm révèlent non seulement M33 mais également son environnement galactique immédiat, incluant les galaxies naines satellites et les filaments de marée potentiels.
Traitement et Analyse d’Image
Le traitement des données brutes nécessite des logiciels spécialisés (PixInsight, Astro Pixel Processor, Siril) pour effectuer la calibration, l’alignement et l’intégration des multiples poses. Les techniques avancées incluent:
- Drizzle integration: augmentation de la résolution spatiale par sur-échantillonnage
- Déconvolution: amélioration de la netteté en inversant partiellement le flou optique et atmosphérique
- HDR multiscale: compression de la dynamique pour révéler simultanément le cœur brillant et les extensions faibles
- Combinaison de filtres: création d’images en couleurs naturelles ou palette Hubble (SHO) pour les données à bande étroite
L’imagerie en bandes étroites centrées sur les raies d’émission révèle avec un contraste exceptionnel les régions de formation stellaire, les nébuleuses planétaires et les rémanents de supernovae. NGC 604, la région HII géante mentionnée précédemment, constitue une cible privilégiée pour l’imagerie haute résolution, révélant une structure filamentaire complexe sculptée par les vents stellaires et les ondes de choc des supernovae.
Perspectives d’Experts et Consensus Scientifique
Les astronomes professionnels considèrent M33 comme un archétype de galaxie spirale de masse intermédiaire en évolution séculaire, offrant des aperçus cruciaux sur les processus régissant la formation stellaire, l’enrichissement chimique et la dynamique des disques galactiques. Le Dr. Julianne Dalcanton, professeure d’astronomie à l’Université de Washington et investigatrice principale du programme PHAT (Panchromatic Hubble Andromeda Treasury), a souligné l’importance scientifique des études de populations stellaires résolues dans les galaxies proches comme M33 pour comprendre les histoires de formation stellaire et les processus d’assemblage galactique.
Les observations interférométriques radio du gaz hydrogène neutre, conduites avec le Very Large Array et le réseau ALMA, révèlent la cinématique détaillée du milieu interstellaire et les sites de formation stellaire naissante. Ces données fournissent des contraintes essentielles sur la distribution de matière noire dans M33, problématique centrale de l’astrophysique contemporaine. Les profils de rotation, construits à partir des vitesses radiales mesurées à différentes positions galactocentriques, indiquent la présence d’un halo de matière noire s’étendant bien au-delà du disque visible, avec une masse totale environ 5 fois supérieure à la masse baryonique.
Les recherches menées à l’Institut d’Astrophysique de Paris et l’Observatoire de Paris, utilisant les données du télescope spatial XMM-Newton, ont catalogué plus de 100 sources de rayons X dans M33, incluant des systèmes binaires X (étoiles à neutrons ou trous noirs accrétant de la matière d’une étoile compagne), des rémanents de supernovae et des noyaux actifs de galaxies d’arrière-plan. Cette population de sources à haute énergie trace l’évolution des étoiles massives et les phases finales de leur existence.
Défis Observationnels et Limitations Techniques
Pollution Lumineuse et Dégradation du Contraste
La faible luminosité surfacique de M33 la rend extrêmement vulnérable à la pollution lumineuse, phénomène de diffusion de la lumière artificielle dans l’atmosphère qui augmente la brillance du fond de ciel et réduit drastiquement le contraste des objets étendus. Dans les environnements urbains ou péri-urbains (classe Bortle 7-9), M33 devient pratiquement impossible à observer visuellement, même avec des instruments de diamètre substantiel.
La quantification de la qualité du ciel s’effectue typiquement via la mesure de la magnitude limite du fond de ciel (Sky Background Magnitude ou SBM), exprimée en magnitudes par seconde d’arc carrée. Un site de qualité exceptionnelle (classe Bortle 1) présente une SBM d’environ 22 mag/arcsec² en bande V, tandis qu’un site urbain modérément pollué (classe Bortle 6) exhibe une SBM de seulement 19-19,5 mag/arcsec². Cette différence de 2,5-3 magnitudes correspond à une augmentation d’un facteur 10-15 de la luminosité du fond, réduisant proportionnellement le contraste des objets faibles.
Limitations Instrumentales et Atmosphériques
La résolution angulaire accessible dépend fondamentalement du diamètre de l’instrument et de la turbulence atmosphérique (seeing). La limite de diffraction théorique, quantifiant le pouvoir séparateur ultime d’un télescope parfait, s’exprime par la relation θ ≈ 1,22λ/D (où λ est la longueur d’onde et D le diamètre). Pour un télescope de 200 mm observant à 550 nm (milieu du spectre visible), la résolution théorique atteint 0,69 seconde d’arc, suffisante pour résoudre les régions HII les plus étendues dans M33.
Toutefois, la turbulence atmosphérique dégrade significativement cette résolution théorique. Dans des conditions de seeing typiques (1-2 secondes d’arc FWHM), les images stellaires s’étalent sur plusieurs pixels, limitant la détection des structures fines. Les techniques d’optique adaptative, bien que couramment employées sur les grands télescopes professionnels pour corriger en temps réel les distorsions atmosphériques, demeurent techniquement complexes et onéreuses pour l’astronomie amateur, bien que des systèmes simplifiés (tip-tilt correction) commencent à émerger sur le marché amateur.
Recommandations Méthodologiques pour Observateurs
Progression Pédagogique
Pour les observateurs débutants, une approche progressive est recommandée:
- Phase initiale: Observation de M33 aux jumelles depuis un site très sombre pour développer les compétences de repérage et la perception des objets de faible luminosité surfacique
- Phase intermédiaire: Observation télescopique à faible grossissement (champ apparent 1-2 degrés) pour visualiser l’étendue complète et percevoir les variations de luminosité surfacique
- Phase avancée: Observation à grossissement moyen (150-250×) ciblant les régions HII individuelles, particulièrement NGC 604, NGC 595 et NGC 592
L’enregistrement systématique des observations (log observationnel) incluant les conditions atmosphériques, l’instrumentation utilisée, les filtres employés et les structures perçues, constitue une pratique scientifique précieuse. Ces données permettent de quantifier objectivement l’amélioration des compétences observationnelles et de corréler la visibilité des structures avec les paramètres environnementaux et instrumentaux.
Coordination avec Observations Professionnelles
Les astronomes amateurs peuvent contribuer significativement à la recherche scientifique sur M33 via plusieurs programmes participatifs:
- Monitoring photométrique: suivi systématique des étoiles variables (céphéides, étoiles variables de type Mira)
- Détection de supernovae: recherche de nouveaux événements transitoires par imagerie différentielle
- Photométrie de régions HII: mesure des variations de luminosité indicatives de fluctuations dans le taux de formation stellaire
Les plateformes collaboratives telles que l’American Association of Variable Star Observers (AAVSO) et le Transient Name Server (TNS) facilitent la soumission et la validation des observations amateur, intégrant ces données aux bases de données professionnelles. Cette synergie amateur-professionnel exemplifie le caractère inclusif et collaboratif de la recherche astronomique contemporaine.
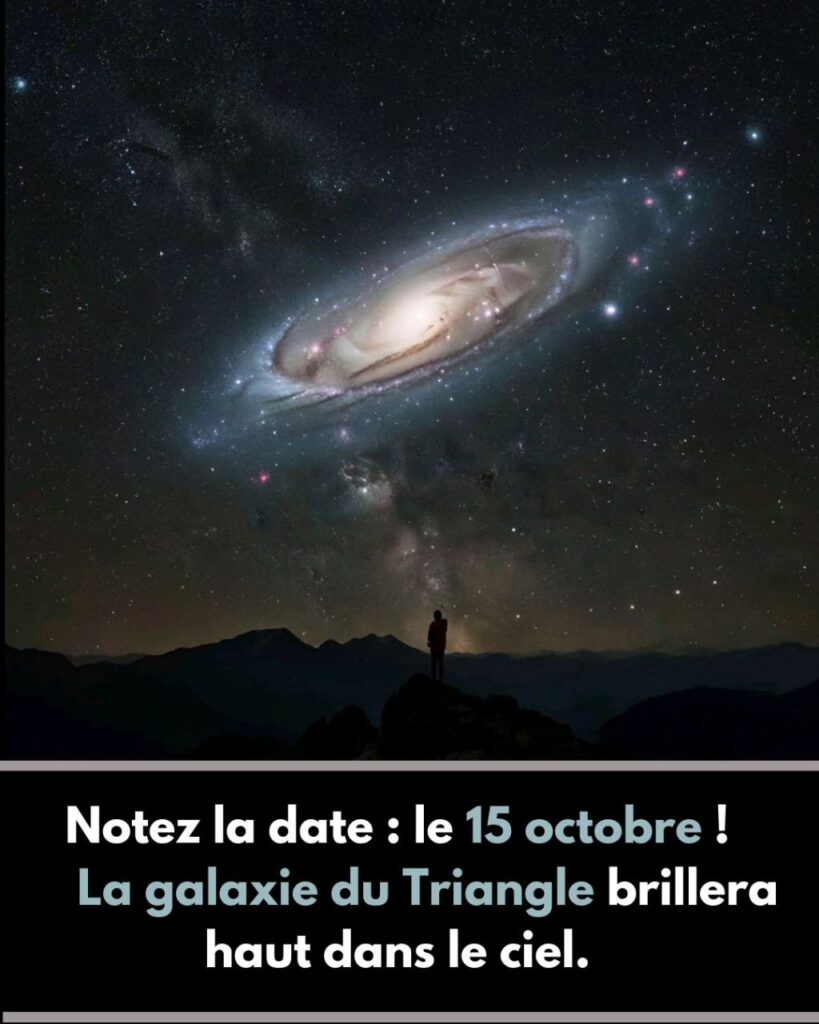
Perspectives Futures et Missions Spatiales
Programmes Observationnels Planifiés
Le télescope spatial James Webb (JWST), avec sa sensibilité infrarouge exceptionnelle et sa résolution spatiale sans précédent, révolutionnera notre compréhension de M33. Les observations prévues dans le cadre du programme GO (General Observer) ciblent spécifiquement:
- Populations stellaires: résolution des étoiles individuelles jusqu’aux naines rouges de faible masse, traçant l’histoire complète de formation stellaire
- Milieu interstellaire: cartographie des hydrocarbures aromatiques polycycliques (PAH) et des poussières chaudes, révélant les sites de formation stellaire obscurcis
- Cinématique 3D: spectroscopie à champ intégral fournissant simultanément position, vélocité radiale et propriétés physiques des régions ionisées
Le futur télescope spatial Nancy Grace Roman, avec son champ de vue 100 fois supérieur à celui de Hubble, effectuera des relevés profonds de M33 et de son environnement, détectant potentiellement les courants de marée ténus et les galaxies satellites de très faible luminosité surfacique qui échappent aux détections actuelles.
Collision Future avec la Voie Lactée
Les simulations numériques de dynamique gravitationnelle à N-corps prédisent que M33, M31 et la Voie lactée subiront une séquence complexe d’interactions et de fusions au cours des prochains 5-10 milliards d’années. Bien que les scénarios détaillés demeurent incertains en raison des mouvements propres imparfaitement contraints et de la distribution de matière noire mal connue, la majorité des modèles suggèrent qu’après la fusion entre la Voie lactée et M31 (prévue dans environ 4-5 milliards d’années), M33 sera soit éjectée du système par interactions gravitationnelles multiples, soit capturée et finalement fusionnée avec la galaxie résultante, formant une elliptique géante.
Ces événements cataclysmiques, bien que s’étendant sur des échelles temporelles dépassant largement la durée de vie humaine ou même celle de notre civilisation, illustrent la nature dynamique et évolutive des structures galactiques. L’observation contemporaine de M33 dans son état actuel fournit une référence cruciale pour calibrer les modèles d’évolution et de fusion galactique, processus fondamentaux ayant façonné l’architecture à grande échelle de l’Univers observable.
Synthèse
La galaxie du Triangle représente bien davantage qu’un simple objet esthétique pour astronomes amateurs. Cette galaxie spirale de masse intermédiaire, accessible aux instruments modestes mais révélant des complexités structurelles sous scrutin approfondi, constitue un laboratoire astrophysique exceptionnel pour l’étude des processus de formation stellaire, d’enrichissement chimique, de dynamique galactique et d’interactions gravitationnelles.
Sa proximité, son orientation favorable et sa population stellaire riche en font une cible privilégiée pour les programmes d’observation systématiques, tant professionnels qu’amateurs. Les contributions scientifiques issues de l’étude de M33 s’étendent de la calibration de l’échelle des distances cosmiques, via les étoiles variables céphéides, à la compréhension de la distribution de matière noire dans les galaxies spirales, problématique centrale de la cosmologie contemporaine.
Pour l’observateur amateur, M33 offre une progression pédagogique naturelle, depuis la détection aux jumelles jusqu’à l’imagerie haute résolution révélant les complexes de formation stellaire individuels. Les techniques observationnelles développées lors de l’étude de M33 – adaptation à l’obscurité, vision décalée, utilisation de filtres sélectifs, traitement d’image sophistiqué – sont directement transférables à l’observation d’objets plus faibles et plus distants, développant les compétences essentielles de l’astronome pratiquant.
L’avenir de la recherche sur M33 s’annonce particulièrement prometteur, avec les capacités révolutionnaires des télescopes spatiaux de nouvelle génération et les programmes de relevés systématiques à grande échelle. Ces observations futures, combinées aux modèles théoriques et simulations numériques de plus en plus sophistiqués, promettent de dévoiler les secrets de cette galaxie discrète mais scientifiquement fascinante, consolidant notre compréhension des processus physiques régissant l’évolution des systèmes galactiques dans l’Univers local.
Sources et Références
Sources principales:
- NASA/IPAC Extragalactic Database (NED) – Messier 33 observational data compilation
- Freedman, W. L., et al. (2001). « Final Results from the Hubble Space Telescope Key Project to Measure the Hubble Constant. » The Astrophysical Journal, 553(1), 47-72
- Corbelli, E., & Salucci, P. (2000). « The extended rotation curve and the dark matter halo of M33. » Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 311(2), 441-447
Données complémentaires:
- Gratier, P., et al. (2010). « Molecular and atomic gas in the Local Group galaxy M33. » Astronomy & Astrophysics, 522, A3
- Williams, B. F., et al. (2018). « The Panchromatic Hubble Andromeda Treasury: Triangulum Extended Region (PHATTER). I. Ultraviolet to Infrared Photometry of 22 Million Stars. » The Astrophysical Journal Supplement Series, 215(2), 9
- Observations du télescope spatial Hubble (programmes HST GO 13750, 15654)
- Cartographie HI du Very Large Array (VLA)
Autorités consultées:
- Institut d’Astrophysique de Paris (IAP)
- Observatoire de Paris – Laboratoire d’Études Spatiales et d’Instrumentation en Astrophysique (LESIA)
- European Space Agency (ESA) – Mission Gaia
- NASA Goddard Space Flight Center
Avertissement
Cet article est fourni à titre informatif et éducatif uniquement. Les techniques d’observation astronomique décrites requièrent une familiarisation progressive avec l’équipement et les conditions nocturnes. Pour l’observation télescopique avancée et l’astrophotographie, il est recommandé de consulter des guides spécialisés et de bénéficier de l’encadrement d’astronomes amateurs expérimentés via les associations d’astronomie locales. Les données scientifiques présentées reflètent l’état des connaissances en octobre 2025 et sont sujettes à révision avec les observations futures.
